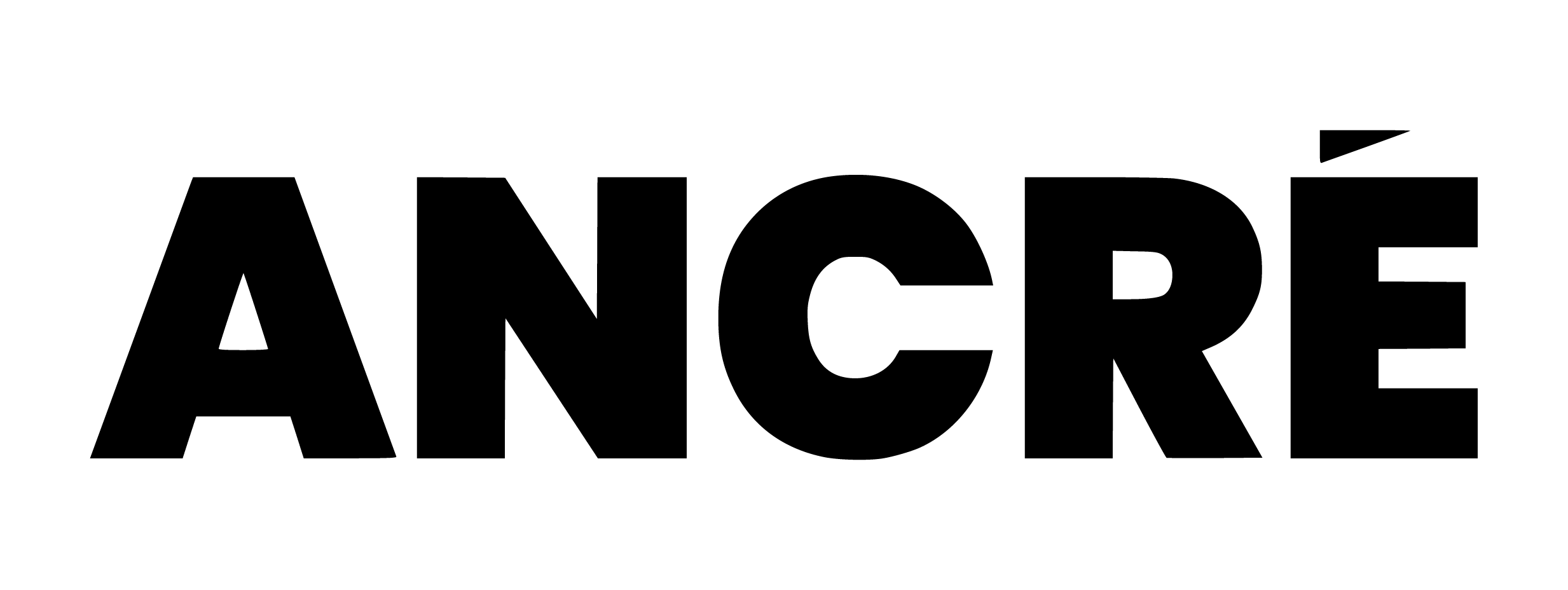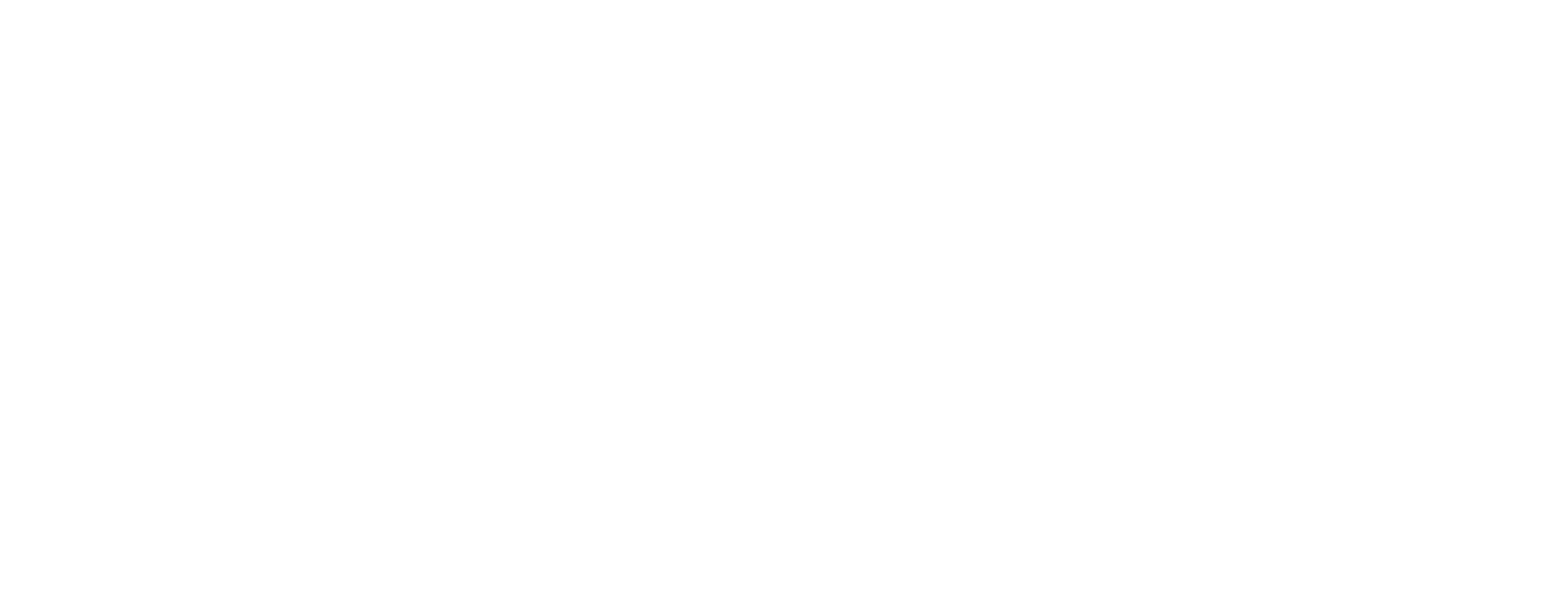On y a cru, et pourtant, la tendance à la diversité sur les podiums est passée aussi vite que qu’une micro-trend sur TikTok. Uniformisation des silhouettes, des âges, des couleurs de peau, des textures de cheveux… La mode redevient ce spectre menaçant qui nous exclut un par un si l’on ne rentre pas dans le moule.

“Il y a quelques années, la diversité de corps a été beaucoup plus célébrée, avec des mannequins plus âgés, des mannequins plus size, des corps plus divers, se souvient Matthieu Bobard Deliere, journaliste et critique mode, avec nostalgie, C’est terrible à dire, mais je dirai qu’il faut voir ça comme une tendance, comme un vêtement qui n’est plus à la mode. » Voir le corps comme un vêtement. La pilule est difficile à avaler, et pourtant. Depuis quelques années, on a vu le corps se transformer au gré des saisons, gonflé à bloc lors de l’era BBL, célébré avec le body-positivisme, affamé avec l’Ozempic. La mode voudrait que l’on change de corps comme de jean, et nous l’a bien fait savoir avec cette dernière saison, plus désolante que jamais en termes d’inclusivité. Pas de doute : la femme 2026 est blanche, mince, jeune. Et sur les réseaux comme dans les médias, cela n’a pas l’air de déranger plus que ça. L’important n’est plus de dénoncer, mais de bien rentrer dans le moule, aussi étroit soit-il.
Un sujet politique avant tout
Pour Matthieu Bobard Deliere, ce retour en arrière n’est que politique. “J’y vois forcément un lien avec la situation sociétale actuelle. On assiste à une fascisation de la société, un retour au conservatisme, et on l’a vu dans la mode, avec l’esthétique de la clean girl. Ça a été un phénomène de dingue qui a tout bousculé. Il fallait revenir à un modèle traditionnel, à celui de la trad wife, de la femme qui prend soin d’elle, mais qui n’en fait pas trop, parce si elle en fait trop, si elle est trop exhubérante, si on la voit trop, ça devient vulgaire, résume le journaliste mode. Même le Président des États-Unis, qui a à priori autre chose à faire, s’intéresse à la tenue des femmes de son entourage, qu’il encourage à “s’habiller comme des femmes”, d’après des sources proches. Comprendre : porter des robes, des talons, du maquillage et correspondre à un idéal beauté venu d’un autre temps, à l’image de sa femme, Melania Trump, aussi bien connue pour son vestiaire impeccable que son mutisme légendaire.
Matthieu Bobard Delire poursuit sont analyse : “La femme actuelle doit prendre soin d’elle, être mince, être jeune, et se faire discrète. Comme il y a vingt ans, mais aussi comme il y a un siècle : si elle est trop voyante, c’est une femme de mauvaises mœurs.” Camille Mbaye, mannequin grande taille, l’avoue : cette tendance de la clean girl a marqué un tournant dans sa carrière. “Comme si le curvy ne rentrait pas dans le clean girl,” s’agace-t-elle. Comme si, au-delà d’un 36, on était “sale”, et surtout, bonne à cacher. Il faut dire qu’avec son 42, son afro et sa couleur de peau, Camille Mbaye représente tout ce qui ne fait plus rêver dans la mode, qui ne mise plus que sur ses anciennes valeurs sûres. “J’ai vraiment la sensation de susciter moins d’intérêt auprès des marques. Je le ressens par mon salaire, je le ressens par ma fréquence de travail, je le ressens au niveau des castings. Ce qui prouve, une fois de plus, que la demande des marques n’est plus à l’inclusivité.”
Rentrer dans le moule, coûte que coûte
Le constat est dur à accepter, mais comment l’ignorer, à mesure que les défilés prêt-à-porter se sont succédés dans la capitale la semaine dernière ? Dans son rapport annuel sur l’inclusivité des tailles lors des différentes Fashion Week, Vogue Business souligne ce qu’on l’on voyait déjà : sur les 9 038 looks présentés lors de 198 défilés et présentations, 97,1 % étaient des tailles standard (jusqu’au 36), 2 % des tailles moyennes (jusqu’au 42) et 0,9 % des tailles plus (44 et plus). Contre 2,8% en 2020. “J’ai commencé à être mannequin il y a cinq ans, donc je pense que j’étais dans le pic du body-positivisme, se souvient Camille Mbaye, Je suis arrivée sur le marché à un moment où il y avait beaucoup de travail. Il y a cinq ans, je ne me demandais pas si j’allais réussir à boucler mes fins de mois. Aujourd’hui, c’est plus compliqué.”
En effet, la mannequin nous confie sentir qu’elle a besoin d’adapter son corps au marché pour continuer d’avoir des opportunités. “Depuis quelque temps, je me suis rendue compte que tout le monde autour de moi avait perdu du poids. Moi aussi, même si on ne me l’a pas dit clairement, j’ai senti qu’il fallait que je perde du poids. Le peu d’opportunités qu’il reste sont pour les midsize, en France, être mannequin plus size, c’est presque devenu impossible.” L’agence Silver, spécialisée dans les mannequins sénior, est quant à elle moins alarmiste : “Sur cette saison nous avons eu un peu moins de demande, certes, mais c’est très fluctuant, nous ne pouvons absolument pas en déduire une tendance. Oui, en effet il y a un manque de diversité sur les podiums, dans cette vitrine qu’est la Fashion Week. Mais nos mannequins seniors travaillent toujours, dans d’autres domaines comme la publicité ou les essayages. Les FW ne sont qu’un tout petit échantillon des prestations assurées par les mannequins.”
Paris, mauvaise élève
Une donnée rassurante mais qui questionne : si les mannequins atypiques travaillent aujourd’hui dans l’ombre, qui est là pour permettre aux personnes lambdas de s’identifier et de se sentir représentés ? “Sans même parler de mon métier de mannequin, voire des filles qui me ressemblaient physiquement, qui avaient la même morphologie, ça me faisait du bien et ça m’aidait à acheter des vêtements, nous confie Camille Mbaye, Quand tu fais une taille 44 et que la mannequin fait un 34, ça n’aide pas à se projeter.” D’après l’Institut français du textile et de l’habillement, les femmes dans le même cas que Camille sont très nombreuses : en France, la moitié des femmes font entre une taille 40 et 44, et un tiers portent du 46 ou plus. On est donc bien loin des corps des mannequins de ces dernières saisons.
“Et pourtant, en Europe, les femmes françaises sont les plus minces !, rappelle Matthieu Bobard Deliere, Malgré tout, Paris reste la pire élève du Big Four en matière d’inclusivité, et notamment au sujet de la minceur. Sur les podiums, la silhouette de la Française moyenne ne se voit pas puisque les vêtements sont à destination d’autres marchés. La cliente qui va s’acheter une tenue chez Dior, chez Chanel, chez Saint-Laurent veut sans doute correspondre à cette image clichée de la Française, à Charlotte Gainsbourg ou à Catherine Deneuve, à ces femmes très minces, très chics, mais qui n’en font jamais trop.” Autrement dit, à pas grand monde.
Une analyse que l’agence Sliver confirme : “Le marché de la fashion week de Paris est très spécifique, les profils recherchés sont assez « classiques ». C’est moins le cas à Londres et à New-York par exemple. Paris est encore beaucoup moins souple et ouverte, la progression est là, mais plus lente ». Un contexte qui rend le travail de Camille Mbaye et consoeurs d’autant plus compliqué. “En France, c’est mort, il n’y a pas de boulot, il n’y a plus rien. Déjà qu’il n’y avait pas grand-chose, mais en France, se développer en tant que mannequin curvy cette année, c’est mort. Franchement, si tu ne vas pas à l’étranger, ça ne sert à rien,” se désole la modèle.
Des réseaux aux podiums
Pour Adel, créateur de contenu et fondateur du Edel’s Blog tout ça, c’est finalement une histoire de demande. “L’inclusivité, que ce soit les tailles, les mannequins racisées ou plus âgées, ça a surtout été une tendance pour montrer que les marques « suivaient » et entendait les plaintes du public. L’inclusivité n’a jamais été la norme : l’industrie a pris son argent, et maintenant, elle change la tendance. On voit beaucoup moins de mannequins seniors maintenant, alors que c’était vachement la mode à un moment. Ce qui devrait être normal devient exceptionnel, et c’est là que ça devient dangereux car ça participe à l’effacement des personnes qui ont besoin d’être représentées.”
Ne l’oublions pas : si nous avons pu assister à l’avènement de mannequins atypiques sur les podiums, c’est aussi grâce aux réseaux, qui remplacent peu à peu les bureaux de tendance, dictant ce que le corps de la femme deviendra à la prochaine saison. “Je pense que le fait d’être plus inclusif à un moment a été propulsé par les réseaux sociaux où on voyait beaucoup plus de gens s’exprimer à travers d’autres canaux, rappelle Matthieu Bobard Deliere, L’image unique qui nous a été véhiculée pendant si longtemps par les médias traditionnels n’était plus la seule option. Le grand mouvement du bodypostivisme a vu émerger énormément d’influenceuses curvy, mais aussi de mannequins plus size, plus âgées, ou qui ne rentraient pas dans les cases comme Winnie Harlow. Et du coup, les marques en ont profité et se sont dit : «peut-être qu’on ferait bien de s’intéresser à cette catégorie de personnes et d’en mettre un petit peu partout, comme ça on pourra aller draguer également une communauté de clientes qui pourront se retrouver dans ces mannequins et dans ces modèles.»”
Mais là où les réseaux sociaux ont été capables du meilleur, ils sont aujourd’hui vecteurs du pire. Le créateur de contenu Adel constate cette injonction à l’uniformisation au quotidien sur ses plateformes : “On a l’impression de revenir un peu en arrière, à une époque où l’on dictait aux femmes comment se comporter, comme exister. Les réseaux sociaux ne font qu’amplifier ça, surtout pour les ados qui se cherchent encore. Des tendances comme celles du « skinnytok » sont vraiment problématiques ». Pour lui, le lien entre le manque de diversité de la Fashion Week et celui des réseaux sociaux s’explique aussi par des front rows, de moins en moins impactants : “Les marques invitent des TikTokeurs qui n’y connaissent rien, qui se montrent aux défilés sans le questionner, sans faire de debrief à leur communauté. Ça contribue à dépolitiser la mode et à la rendre plus superficielle.”
De parents palestino-algériens, l’influenceur estime d’ailleurs que son origine constitue un frein à ses invitations aux défilés, malgré son contenu particulièrement orienté mode. “Quand tu es une personne racisée, c’est bloquant. On m’a dit que j’étais ghetto, ou qu’il fallait «plaire aux Blancs». Et on ne nous invite pas. Ou quand les marques invitent des personnes racisées, ce sont des personnes qui leur ressemble. On voit de moins en moins de darkskin dans la mode par exemple. Et les rares fois où ça arrive, comme Aya Nakamura qui devient la première femme noire en couverture de Vogue France depuis Naomi Campbell, on applaudit. Et c’est très grave, parce qu’on applaudit parce que c’est rare. Parce qu’enfin, on a un petit morceau de représentation.”
Aya Nakamura est en couverture du premier numéro de Vogue France ! Charismatique et talentueuse, la divine diva se livre dans ce numéro d'exception, en kiosque le 4 novembre. #VogueFrance @AyaNakamuraa
— Vogue France (@VogueFrance) November 2, 2021
© Photographie : Carlijn Jacobs – Réalisation : Gabriella Karefa Johnson pic.twitter.com/PkAFkqtBn2
Un secteur qui va mal
Ce qui était autrefois payant est devenu un risque. Et pour les grosses maisons, risquer de perdre des clients à une époque aussi incertaine économiquement que la nôtre pourrait s’avérer fatal. “La mode va mal. C’est la crise partout dans le pays, partout dans le monde, mais c’est la crise aussi dans la mode. Et du coup, on se dit qu’on ne va pas prendre de risques en mettant des mannequins plus size, en mettant des mannequins racisés et qu’on va plutôt aller vers les choses plus traditionnelles qui ont déjà marché, explique Matthieu Bobard Deliere, N’oublions pas que nous sommes un contexte de fascisation, de conservatisme, de montée de l’extrême droite partout dans le monde.” Et qu’en cas de crise, les gens ont surtout besoin de se rassurer, en se tournant vers des choses qu’ils connaissent.
Heureusement, à y regarder de plus près, certaines marques continuent de résister aux normes imposées par la mode, à l’image de Xuly.Bët qui, sur 44 looks, a présenté 43.2% de silhouettes midsize et 34.1% de mannequins plus size, ou encore comme Matières Fécales, et Cecilie Bahnsen qui ont non seulement fait défiler différents corps sur leurs podiums, mais aussi des femmes d’âges mûrs. “Les jeunes marques sont souvent plus progressistes sur ces sujets-là, poursuit le spécialiste mode, Aussi parce qu’elles ne sont pas régies par les grands groupes, les conglomérats. Elles ont moins la pression de correspondre à un chiffre de vente ou à une image qui pourrait faire peur à une clientèle.” Le journaliste poursuit : “Elles sont aussi souvent détenues par des créateurs de notre génération, qui ont envie de faire une mode qui leur ressemble, avec des personnes queer, trans, plus size, racisées… Et tout ça dépend aussi de la cliente à qui s’adresse la marque : typiquement, Chanel n’est pas la même clientèle que celle de Matière fécale !”
La jeunesse serait-elle la solution ? Pour Adel, 21 ans, cela ne fait aucun doute : “Ma génération essaie de résister à ça et de montrer que tous les corps comptent, mais l’industrie continue de dicter des standards assez irréalistes. On n’est pas complètement alignés avec eux, et heureusement, parce qu’on essaie de changer un peu les choses.”
16 octobre 2025