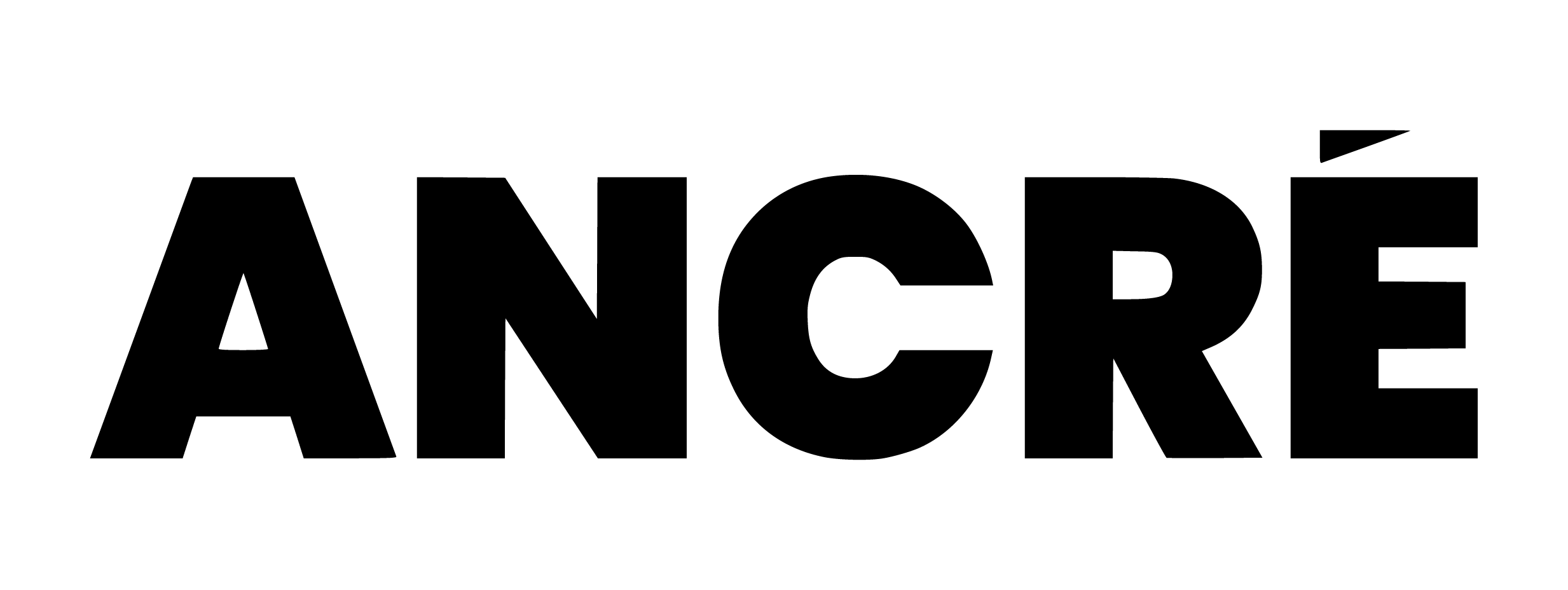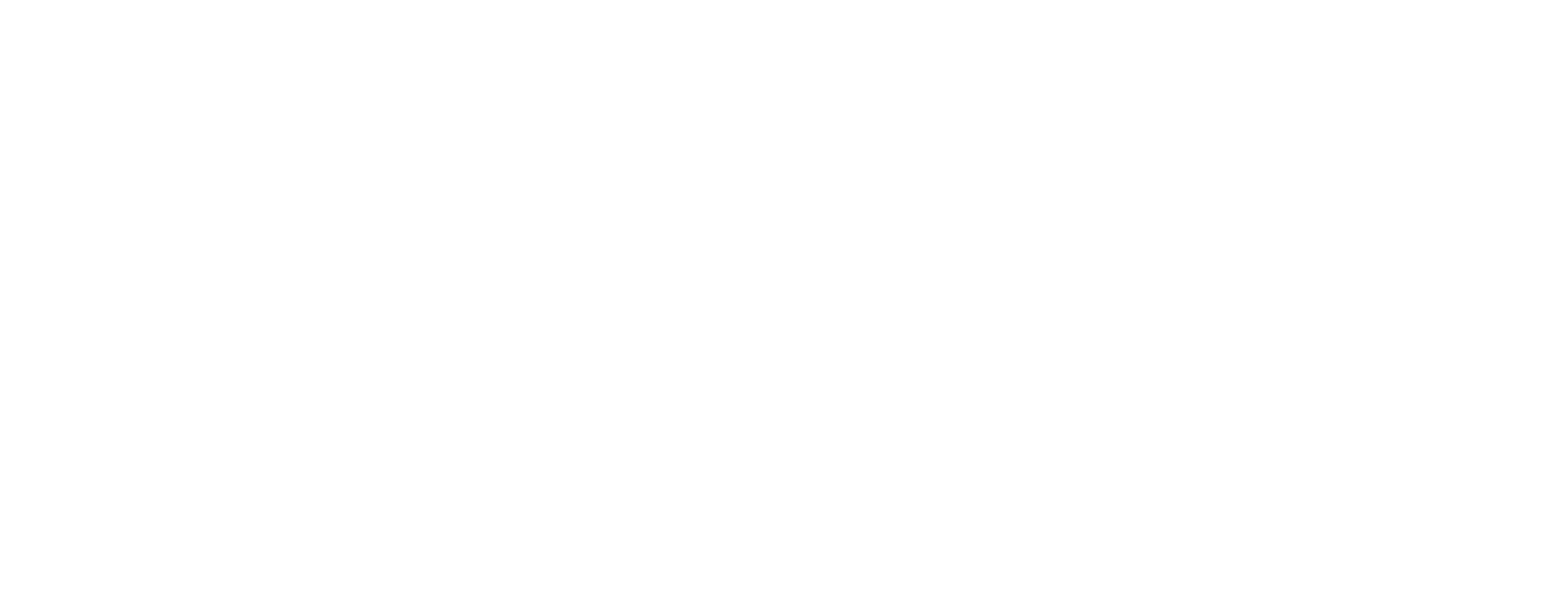Visage couvert et corps sculpté : l’arrivée de Kim Kardashian au gala de l’Academy Museum incarne à elle seule la déshumanisation des femmes encouragée par l’industrie de la mode.

Il fallait savoir que c’était elle. Sur le tapis bleu du 5ème gala annuel de l’Academy Museum, une silhouette couleur chair s’avance, entre corset étouffant et visage drapé d’un tissu beige maintenu par un imposant collier choker. Kim Kardashian, reine du buzz, a encore frappé dans cette silhouette signée Maison Margiela. Elle semble à peine pouvoir respirer, et pourtant, les photographes s’extasient. Notre œil se serait-il habitué à la souffrance féminine sous couvert de mode et de griffe de luxe ? À en croire les derniers défilés, manifestement Kim K n’est pas aussi subversive qu’elle veut bien le croire : elle incarne simplement une tendance qui infuse. Celle de couvrir les visages des femmes pour en révéler les corps, mis à la disposition d’un public aguerri toujours plus avide de sexualisation.
Faut-il souffrir pour être belle ?
“Quel est le but de la mode féminine ? Créer des outils d’épanouissement personnel ? Profiter de l’insécurité ? Se forger une nouvelle place dans le monde grâce au tissu ?, questionne la journaliste Vanessa Friedman pour le New York Times, Telles étaient les questions soulevées à la fin d’une Fashion Week parisienne qui présentait des vêtements qui cachaient, confinaient, muselaient, voire effaçaient les femmes qui se cachaient.” En bon représentant de cet effacement progressif de la femme au profit d’un vêtement contraignant, Courrèges ne dévoilait presque aucun regard lors de son dernier défilé parisien. Dissimulés derrière des sortes de grandes raquettes, des voiles ou des lunettes de soleil, les yeux des mannequins importent finalement peu au créateur. Ce qui compte, pour Nicolas Di Felice, ce sont ces jambes interminables, ces hanches et ces poitrines toujours plus exposées, et cette peau contrainte par des robes lassées, directement inspirées de la pratique du Shibari, sans que cela ne soit pour autant jamais revendiqué par la maison.
Camisoles enfermantes chez Alaïa, écarteurs de bouche métallique chez Margiela, pinces-téton chez Mugler… Côté inspiration, les créateurs ont puisé dans l’univers de la psychiatrie ou dans celui du sado-masochisme. Afin de nourrir leurs propres fantasme ? “Je peux vous dire que cette robe était un coup monté sur les réseaux sociaux pour devenir virale, assure la critique mode Pran Jallijain au sujet justement de la “nipple-piercing dress”, Encore une fois, un homme utilise le corps d’une femme pour choquer.” Car si le nouveau directeur créatif de la maison Miguel Castro Freitas s’est caché derrière la réinterprétation d’une robe d’archive de Thierry Mugler, difficile de ne pas y voir de notre côté une renaissance de la fameuse esthétique “porno-chic” des années 2000. Le créateur portugais n’est d’ailleurs pas le seul à avoir surfé sur ce revival. Demna chez Gucci, Dario Vitale chez Versace, Haider Ackermann chez Tom Ford… Même Daniel Roseberry chez Schiaparelli, d’habitude si raffiné, a cédé aux sirènes des robes lacérées, comme si les mannequins avaient été attaquées avant de monter sur le podium. Mettre les femmes en position de vulnérabilité, là où la mode célébrait encore très récemment l’empowerment, qu’est ce que cela dit de notre société ?
Par les hommes, pour les hommes
Sur TikTok, une trend offre un élément de réponse. Autour de la phrase : “There are designers who hate women and there are designers who love women”, un jeu consiste à devenir le lien d’un créateur (masculin) avec les femmes qu’il habille. Et à y regarder de plus prêt, cette saison, à Paris, peu d’entre eux tiennent à célébrer pleinement leurs clientes. “Les hommes ont des visions plus spectaculaires de la mode, avec des grands décolletés, notamment, rappelle la critique mode Saveria Mendella pour France 24, Comme dans une version 100 % male gaze de la création. Et ce qui est vrai aujourd’hui l’a plus ou moins toujours été, comme avec Christian Dior qui dessinait une silhouette féminine inspirée d’une femme fantasmée, une revendication toujours vivace aujourd’hui chez beaucoup de créateurs.” Sa collègue, Audrey Millet, historienne spécialiste de la mode et autrice du « Livre noir de la mode » (Les Pérégrines), l’affirme : les hommes créent souvent une mode visuelle, aussi contraignante soit-elle, quand les femmes, elles, imaginent des vêtements praticables, séduisants pour elles avant de l’être pour les autres. “Les modèles sont plus faciles à porter, les chaussures aussi, s’ils ont été créés par une femme. Sonia Rykiel, avec ses gilets en maille et ses petites robes faciles à porter pour aller travailler, a libéré le corps des femmes.”
Le problème ? Cette année, le mercato de la mode n’a laissé que très peu de place aux femmes à la direction des grandes maisons. Et les nominations de Sarah Burton chez Givenchy l’an dernier, de Maria Grazia Chiuri chez Fendi et, plus récemment, Grace Wales Bonner chez Hermès, loin de constituer une règle, font figure d’exception. Une mainmise qui s’explique d’abord par les profils similaires des patrons de grands groupes de luxe qui, de LVMH à Kering, sont des hommes, blancs, âgés, et conservateurs. Pour l’autrice américaine Dana Thomas, spécialiste de l’industrie du luxe, citée par Fashion Network, la postérité des grandes griffes fondées par des femmes n’a également pas été respectée. “Chanel, fondée par la femme la plus célèbre et influente de la mode, Gabrielle « Coco » Chanel, a manqué une opportunité en ne recrutant pas une femme directrice artistique”. Et c’est loin d’être le seul exemple. On peut citer Schiaparelli, Lanvin ou même Celine qui, si elles ont été créées par des femmes, « ont aujourd’hui toutes des hommes comme directeurs artistiques” à leur tête. Le reste sont des marques éponymes, encore dirigées par leurs fondatrice comme Stella McCartney, Victoria Beckham ou Miuccia Prada chez Prada et Miu Miu.
Quand la misogynie prend place dans notre dressing
Pour la Belge Karen Van Godtsenhoven, spécialiste de mode à l’Université de Gand en Belgique, interrogée par l’AFP, “le Covid a joué un rôle dans la société en général en faisant revenir des modes de pensée plus conservateurs et réactionnaires. Pour l’industrie de la mode, cela a signifié un retour aux vieilles certitudes du designer masculin solitaire”. Un retour en arrière que les femmes elles-mêmes sont presque obligées d’incarner pour tenter de rester dans le paysage. Une position d’ailleurs particulièrement visible chez Miuccia Prada qui, avec Miu Miu, a presque grimé ses mannequins en tradwife à grands renfort de tabliers (censés pourtant incarner “une réflexion sur le travail des femmes – leurs défis, leurs adversités, leurs expériences”) et a agrémenté une large partie des silhouettes de Prada de gants de vaisselle de luxe. Si la note d’intention surfe sur une ambiguité avec le féminisme, difficile, là encore, de ne pas voir un fantasme masculin s’assouvir : celle d’une femme domestique et domestiquée. Pour Elke Gaugele, professeure agrégée et anthropologue, spécialiste en culture mode et en politique visuelle à l’Académie des beaux-arts de Vienne, interrogée par Vogue, pas de doute : la tradwife joue un rôle stratégique pour les marques. “Dans un climat où les idées conservatrices gagnent en visibilité et en acceptabilité sociale, ces figures permettent aux marques de se positionner subtilement tout en conservant un large attrait.”
Entre tradwife et SM, la mode parisienne a réussi son pari de représenter tous les fantasmes masculins. On est (très) loin du t-shirt “We Should All Be Feminists” de Dior en 2016. Un triste constat appuyé par le journaliste mode Loïc Prigent, invité dans le podcast d’Alice Moitié qui l’affirme : “La mode se fout de tes psychoses, de tes blessures, ils veulent juste te sculpter dans le marbre. C’est le milieu le plus misogyne. Alors que les femmes en sont les principales clientes.”
23 octobre 2025