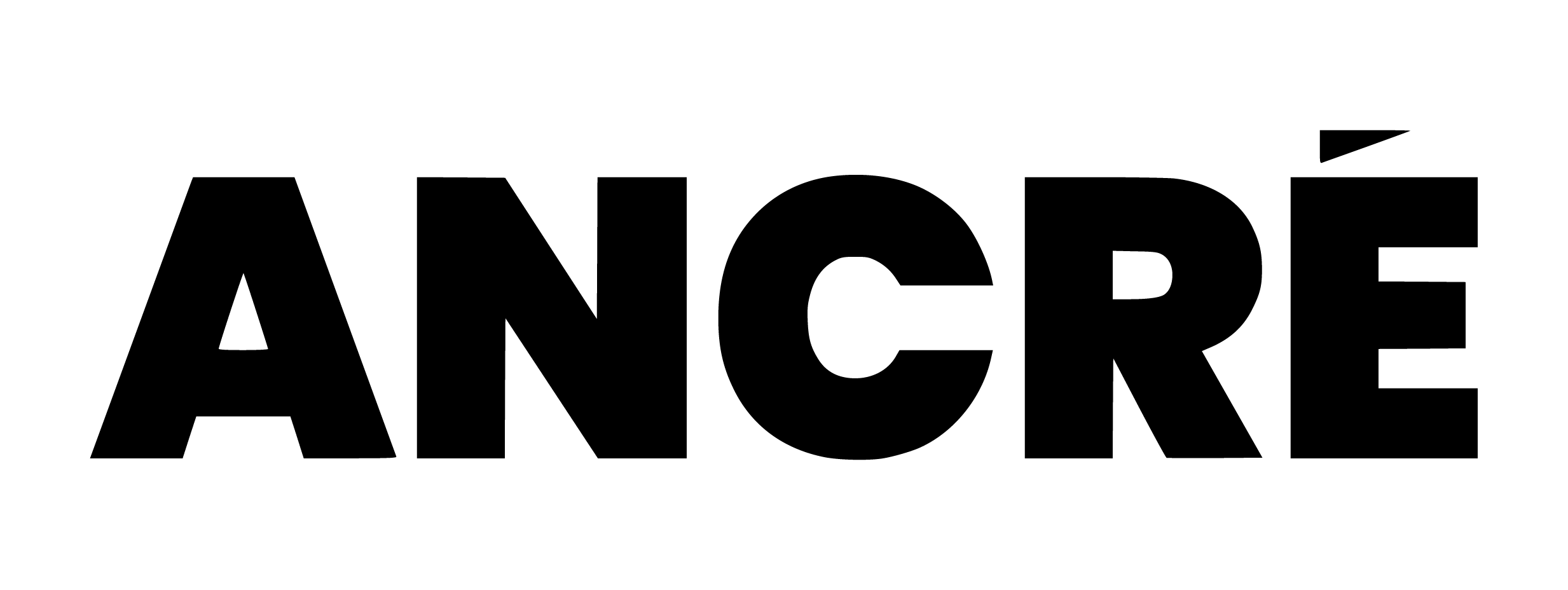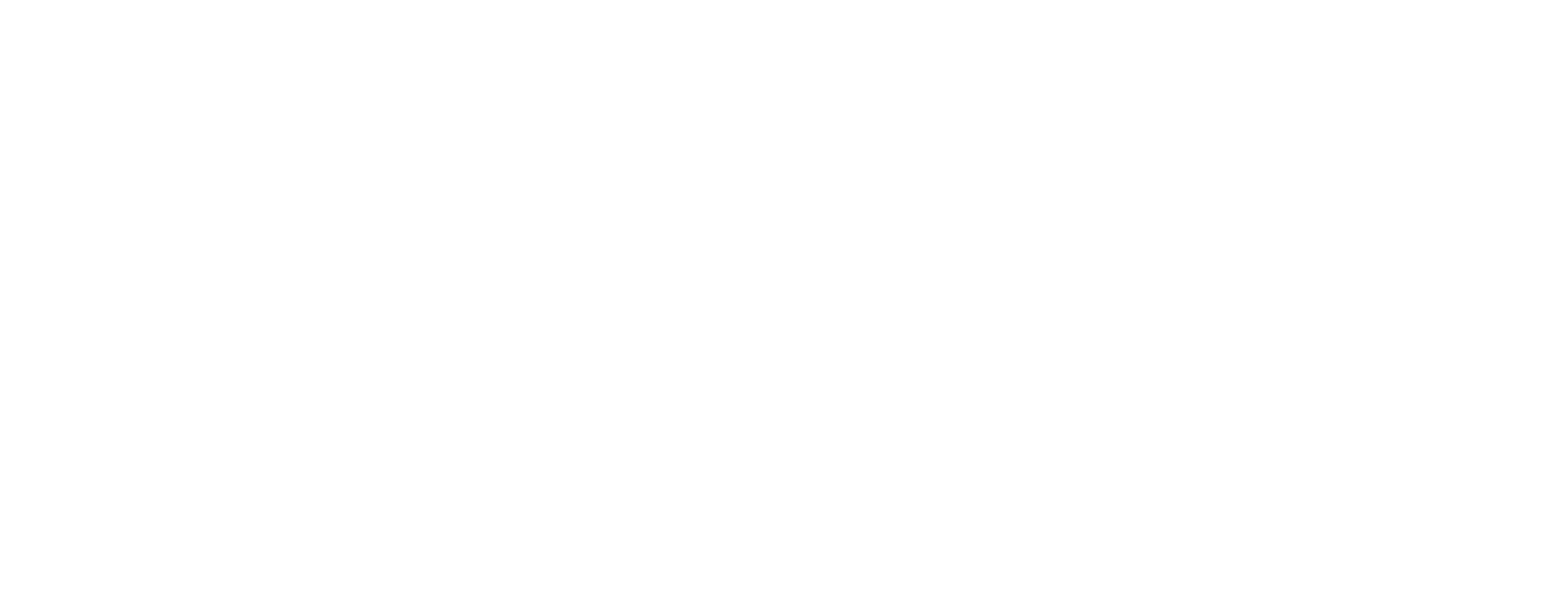Déclaré non coupable de trafic sexuel et d’extorsion et association de malfaiteurs (uniquement de transport à des fins de prostitution), Diddy incarne-t-il la mort du mouvement MeToo ?

Malgré une trentaine de témoignages glaçants d’anciennes compagnes – Cassie en tête de file -, d’anciens collaborateurs ou de prostitués impliquées dans les fameuses orgies du magnat du hip-hop, le couperet est tombé mercredi 2 juillet : non-coupable. Alors qu’il risquait la prison à vie, il encourt finalement jusqu’à 20 ans maximum, qui pourraient même se transformer en une peine de cinq ans et quart, selon les procureurs. Alors, comme beaucoup, on s’est demandé comment croire en la justice quand le procès le plus médiatisé de la décennie ne la rend pas aux femmes ? Après R.Kelly, Harvey Weinstein ou Jeffrey Epstein, on pensait assister à la fin de l’impunité des hommes de pouvoir envers les femmes. Au terme des deux mois de procès douloureux, le jury composé de 12 personnes a acquitté le boss de Bad Boys Records des chefs d’accusation les plus lourds. Et ont condamné les victimes au silence.
« Notre corps, leur choix »
Alors qu’à l’annonce du verdict, Diddy remerciait le ciel pudiquement, à l’extérieur du tribunal, c’est l’euphorie. Des fans s’aspergent d’huile pour bébé quand d’autres pleurent de soulagement. Leur héros ressort vainqueur d’un procès sur lequel personne ne misait. Sur le compte du média à scandale Shade Room, des milliers de commentaires qualifient les témoins féminin de “304” (un argot qui signifie “prostitué”) et prennent notamment Cassie à partie en remettant en question son statut de victimes. Sur d’autres canaux – comme le nôtre -, des femmes du monde entier désespèrent d’un tel verdict. Et prennent personnellement cette décision de justice. Car cette dernière représente l’apogée d’une nouvelle ère masculiniste qui infuse de plus en plus dans la société, illustrée par le “Ton corps, mon choix” de Nick Fuentes entonné à l’annonce de la victoire de Trump. Il faut dire que, dans l’Amérique de Donald, où le droit à l’avortement perd de plus en plus de terrain, le nombre d’hommes républicains affirmant que les femmes devraient retrouver des rôles plus traditionnels est passé de 28 % à 48 % en deux ans.
Topless women celebrating outside the courthouse with baby oil after the Diddy trial 👀😭 pic.twitter.com/bbIa5iitcN
— CultureClips (@CultureClips_) July 3, 2025
Notre corps est-il définitivement celui des hommes ? Dans un article de The Cut, la journaliste Andrea González-Ramírez, se désole : “À l’époque pleine d’espoir du mouvement #MeToo, lorsque les victimes offraient courageusement leurs blessures au monde, je croyais que leur exemple guiderait et que nos institutions suivraient. Était-ce naïf ? Aurais-je dû me résigner à l’idée que la violence ancrée dans nos structures patriarcales serait beaucoup plus difficile à vaincre ? Avais-je trop confiance en la capacité de notre société à faire preuve de compassion plutôt que d’insensibilité ? Je crains que la réponse à toutes ces questions soit oui, oui et oui.”
« Free Diddy » ou la mort de MeToo ?
Car alors qu’il y a peu, les femmes libérant leur parole sur des abus subis étaient érigées en héroïnes, elles sont, aujourd’hui, rendues au rang de paria. Au mieux. Cassie, passée par cet humiliant procès malgré un accord au civil pour tenter d’échapper à cette mise à mort publique, a été présentée par la défense de Diddy comme la grande gagnante de cette histoire, “une femme qui aime vraiment le sexe” qui est “quelque part dans le monde avec 30 millions de dollars”. Jamais comme une victime.
But all these women lied though, Cassie could have walked away anytime but she just wanted the money and fame https://t.co/eR4GYWZGbI
— Kingslayer (@drkstranger) May 17, 2025
Car avec des phrases comme “ton corps, mon corps” intrinsèquement lié à un président qui se ventait d’attraper des femmes “par la ch*tte”, la question du consentement est centrale. Bien que Cassie et Jane aient dit qu’elles s’étaient senties forcées et contraintes (notamment financièrement) d’avoir recours à ces orgies, la défense a insisté sur la nature consensuelle de leur relation avec Sean Combs. Ce qui aurait contribué à faire tomber le chef d’accusation de trafic sexuel. Rappelons notamment que Donald Trump lui-même, proche de Diddy et dont les hôtels ont été largement cités lors des deux mois de procès, a émis l’hypothèse de gracier le rappeur en cas de condamnation.
Comment réagir, en tant que femme, quand même les puissants offrent l’impunité aux agresseurs ? Pour la journaliste Helena Andrews-Dyer, qui réagit dans un podcast du Washington Post, ce procès marque officiellement le déclin du mouvement. “Il y a une forme de fatigue culturelle et un retour en arrière au sujet de MeToo. Ce procès fait office de baromètre au sujet de la manière dont nous percevons ce mouvement aujourd’hui. Parce que la question du consentement a justement soulevé de nombreuses conversations entre adultes, qui se voient rediscuter de ce qui serait ou non le consentement.” Elle est rejointe par la reporter Anne Branigin, qui soulève la question de la parité du jury : “Dans ce jury de 12 personnes, huit sont des hommes, qui devront considérer des questions telles que “que signifie donner son consentement pour un acte, mais pas pour un autre ? Qu’est ce que cela signifie de consentir à un acte sexuel, mais pas à celui dont nous parlons actuellement ?.”
« Il y a assez d’hommes noirs derrière les barreaux »
L’autre volet de ce procès est moins flagrant, peut-être plus délicat à traiter, notamment d’un point de vue français. Difficile d’ignorer que sur le parvis du tribunal, les fans scandent surtout des slogans célébrant la “justice rendue à un homme noir”. Car oui, écarter la question raciale, c’est omettre tout un pan de la réception de cet évènement. “Même avant que ce procès ne commence, l’équipe de Combs a publiquement appuyé sur le fait que la race était un facteur majeur dans pourquoi et comment il était jugé. Que, fondamentalement, Sean Combs était traité injustement parce qu’il était un homme noir et que des hommes blancs avaient engagé ce genre de comportement fans faire face aux mêmes conséquences,” rappelle Anne Branigin.
Constituant un tiers de la population carcérale aux Etats-Unis, les hommes noirs sont les premières cibles du système judiciaire américain. Là où les hommes noirs ne peuvent échapper à des peines lourdes, Diddy a réussi l’impossible : être un homme de couleur, riche, qui s’en sort, même face à un juge et à un tribunal médiatique peu aquis à sa cause. “En tant que Noirs, il y a une méfiance envers le système judiciaire dans ce pays parce que nous savons qu’il n’a pas été conçu par les minorités. Il a été conçu pour opprimer à bien des égards,” rappelle Helena Andrews-Dyer. Alors quand l’avocat de Diddy apprend les charges qui pèsent contre son client, il attaque en rappelant que le transport à des fins de prostitution s’appuient sur une loi vieille de 115 ans, initialement appelée “White Slave Traffic Act”, aujourd’hui connue sous le nom de “Mann Act”, largement utilisée pour poursuivre des personnes noires qui auraient eu des rapports avec des personnes blanches au début du XXème siècle. Avant le procès, l’accusé avait tenté d’obtenir l’abandon de ce chef d’accusation en invoquant “les origines racistes de cette loi”. Sa demande avait été rejetée. Quand a juré a été démis de ses fonctions pour avoir menti sur sa déposition, la défense s’y est opposé, car il s’agissait d’un juré noir, et a alors estimé que le jury n’était plus assez divers.
Seeing so many black men celebrate Diddy is disturbing, disgusting and extremely disappointing.
— Maya 🦋♓️🌻 (@auroramonroe___) July 2, 2025
MeToo contre BLM ?
En même temps que le symbole du déclin du féminisme, Diddy devient celui de l’homme afro-américain opprimé que même la justice ne peut faire coucher. Une sorte d’O.J des temps modernes, qui divise aussi bien l’Amérique que le monde. Celui qui prospère au même titre qu’un Blanc. D’ailleurs, le rapprochement avec O.J Simpson a été entretenu par Diddy et ses avocats, qu’il surnome « la dream-team », comme le joueur de football à son époque. “La question n’est pas de savoir si Combs est coupable, mais si sa prise de conscience publique reflète une application cohérente de la justice ou une réponse culturellement surdéterminée et disproportionnée, façonnée par les angoisses persistantes des Américains concernant la race, le pouvoir et la masculinité, rappelle le sociologue Ellis Cashmore dans les colonnes du Fair Observer, [Dans le cas de MeToo], les questions raciales sont souvent marginalisées. Lorsque des hommes blancs sont accusés, le scénario se concentre généralement sur des manquements moraux ou des problèmes psychologiques individuels. Lorsque des hommes noirs sont impliqués, le récit peut prendre un sens différent , renforçant de manière peu subtile les stéréotypes ancestraux de l’hypersexualité, de la sauvagerie et du manque de maîtrise de soi.”
Et ça, la défense a bien insisté dessus : Diddy est un homme “au mode de vie échangiste”. Rien de plus. Et quiconque oserait dire le contraire serait aveuglé par ces préjugés. Représentant le tiraillement des luttes de notre époque, le procès se situe au confin des grands mouvements sociaux. Et donne aux Américains l’étrange sensation de devoir choisir un camp. “Rien de tout cela ne vise à exonérer les auteurs de méfaits. La condamnation de R. Kelly , les poursuites civiles et l’emprisonnement de Cosby (plus tard annulés), ainsi que la peine purgée par Tyson pour viol reposaient toutes sur des accusations crédibles et, dans certains cas, sur des preuves accablantes. Pourtant, la tendance générale invite à l’interrogation. L’Amérique est-elle plus encline à croire le pire au sujet des hommes noirs ?,” questionne Ellis Cashmore, sans offrir de réponse.
Et la suite ?
Alors, qu’adviendra-t-il du procès civil ? Car si Diddy a remporté une bataille, il est loin d’avoir gagné la guerre. Rappelons qu’il fait actuellement face à plus de 70 plaintes pour viols, abus sexuels (dont certains sur mineurs), harcèlement ou encore création de contenu pornographique sans consentement. Avec ce premier verdict en demie-teinte, on ne peut qu’être pessimiste quant aux sentences qui l’attendent à la suite de ce prochain procès dont la date est encore inconnue. Et comme le dit très justement Andrea González-Ramírez, “il y a sept ans, on aurait cru que nous allions vers un monde où Cassie serait crue.” Qu’en sera-t-il alors des dizaines de victimes qui viendront témoigner à la barre du civil ? Raviront-elles l’espoir d’un monde où les victimes d’abus se font entendre, pour de vrai, qui que soit leur bourreau ?
6 juillet 2025