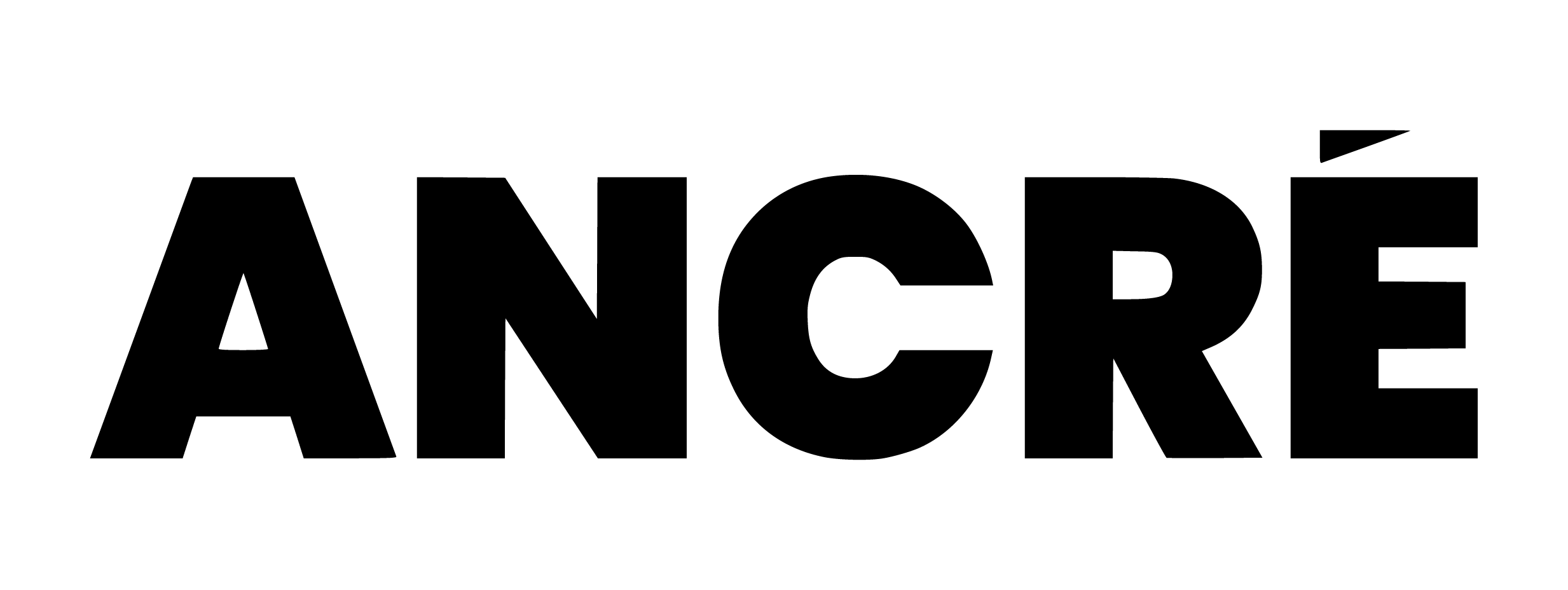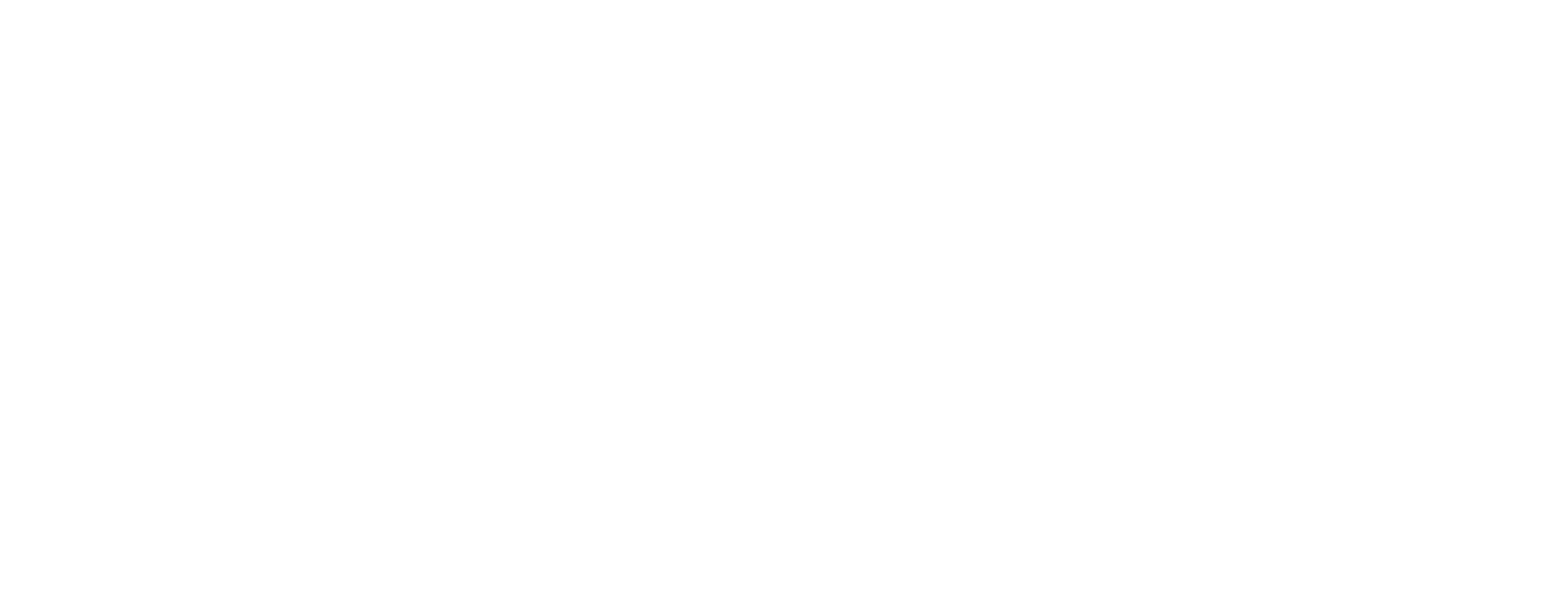Ce que la récente fermeture des toilettes de la célèbre chaîne de café dit du capitalisme made in America et de la crise des toilettes publiques qui secoue le pays. Et en particulier, les femmes.

En avril 2018, deux hommes noirs demandent à utiliser les toilettes d’un Starbucks de Philadelphie, ce qui leur est refusé par un employé qui appelle rapidement la police pour signaler “une intrusion”. C’est le début du scandale. Taxé de raciste par l’opinion publique, la chaîne ferme alors immédiatement tous ses cafés américains le temps d’un après-midi consacré à une formation obligatoire contre les préjugés raciaux… avant d’annoncer l’ouverture de ses WC pour tous, clients ou non.
Seulement, six ans plus tard, Starbucks fait machine arrière, réservant désormais les toilettes de ses établissements nord-américains aux consommateurs. Des changements justifiés par des performances décevantes de l’entreprise, qui a enregistré une baisse de 6% de ses ventes aux États-Unis. L’histoire pourrait s’arrêter à une simple histoire de choix d’entreprise. Seulement, la décision de Starbucks de limiter l’accès à ses toilettes aux clients payants a mis en évidence un problème plus vaste : mais où les Américains – et notamment les Américaines – font-ils ou elles leur besoin ?

L’absence de toilettes publiques
En effet, si à Paris, il n’est pas rare de se faire refouler d’un bar lorsque l’on souhaite utiliser les toilettes sans commander, il y a toujours la possibilité de se replier sur l’un des 400 sanitaires gratuits de la capitale. Une option qui n’existe quasiment pas aux États-Unis, les autorités affirmant que l’installation de toilettes publiques coûterait des “centaines de millions”, d’après un article du Washington Post signé Harvey Molotch, auteur de l’ouvrage Toilet: Public Restrooms and the Politics of Sharing, qui s’insurge : “Mais il en a fallu bien plus pour installer des lignes électriques, des voies de circulation pour camions et des infrastructures industrielles. Quel mal y a-t-il à les consacrer à nos corps ?” Résultat : à New-York, on compte quatre toilettes pour 100 000 habitants, quand, à Paris, on en compte un pour 3 000.
Entre alors en course, l’éternel argument de la dégradation et des difficultés d’entretien. Vandalisme, drogues ou relations sexuelles freineraient les autorités à développer ces infrastructures, tout comme les établissements privés à laisser libre l’accès à leur WC. En effet, en 2013, une étude affirmait que 58% des gérants de boutiques et restaurants avaient déjà constaté de la consommation de drogue dans leurs toilettes. “En fait, à cause de la peur de ce que certaines personnes pourraient faire, tout le monde est amené à souffrir,” résume Harvey Molotch.

Les toilettes : théâtre de la lutte pour l’égalité homme-femme
Les premières à souffrir de ces décisions d’urbanisme ? Les femmes, comme le constate Lloyd Alter, professeur de design durable à l’Université de Toronto : “Les hommes peuvent uriner n’importe où, mais les femmes enceintes et en période de menstruation ont souvent désespérément besoin d’une salle de bain et n’ont pas la possibilité de se faufiler dans une ruelle », rappelle l’expert. Car oui : les sanitaires sont un véritable sujet sur lesquels s’appuient de nombreuses études de genre. Aux États-Unis, où le sujet est débattu depuis des décennies, on a même assisté à la naissance du mouvement féministe militant “potty parity” visant à construire des toilettes supplémentaires pour les Californiennes dans les nouveaux bâtiments publics. Un sexisme qui concerne même les élues du Congrès américain, qui ont dû utiliser les toilettes dédiées au public jusqu’en 2011, année où elles ont enfin eu accès à des sanitaires personnelles.
Pour le chercheur en sciences politiques Julien Damon, auteur de l’étude « Les toilettes publiques : un droit à mieux aménager », le sujet des WC est « révélateur d’inégalités manifestes et terrain de possibles innovations ». Pour argumenter, le sociologue s’appuie sur un chiffre : les femmes passeraient 2 à 3 fois plus de temps aux toilettes que les hommes en raison de différences physiologiques. Une différence non prise en compte dans la construction de ces infrastructures qui entraîne des temps d’attente beaucoup plus longs pour la gente féminine. Mis en lumière par une étude belge réalisée par Kurt Van Hautegem et Wouter Rogiest, ce temps d’attente s’élève à 6,19 minutes pour les femmes contre 11 secondes pour les hommes pour deux espaces de superficies strictement égales.
La différence de queue aux WC hommes et aux WC femmes…. Mdrrrr
— 𝔐𝔢𝔩𝔬𝔲 (@toumaftWOTE) September 9, 2019
30 janvier 2025