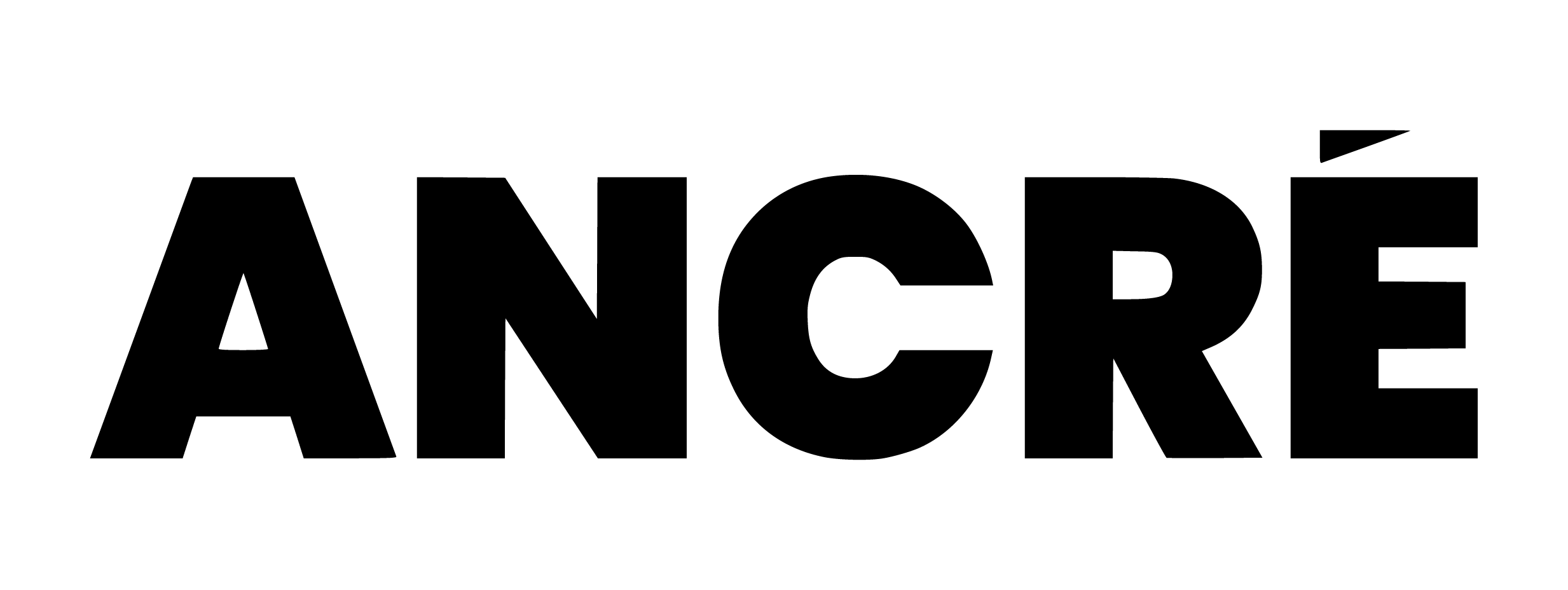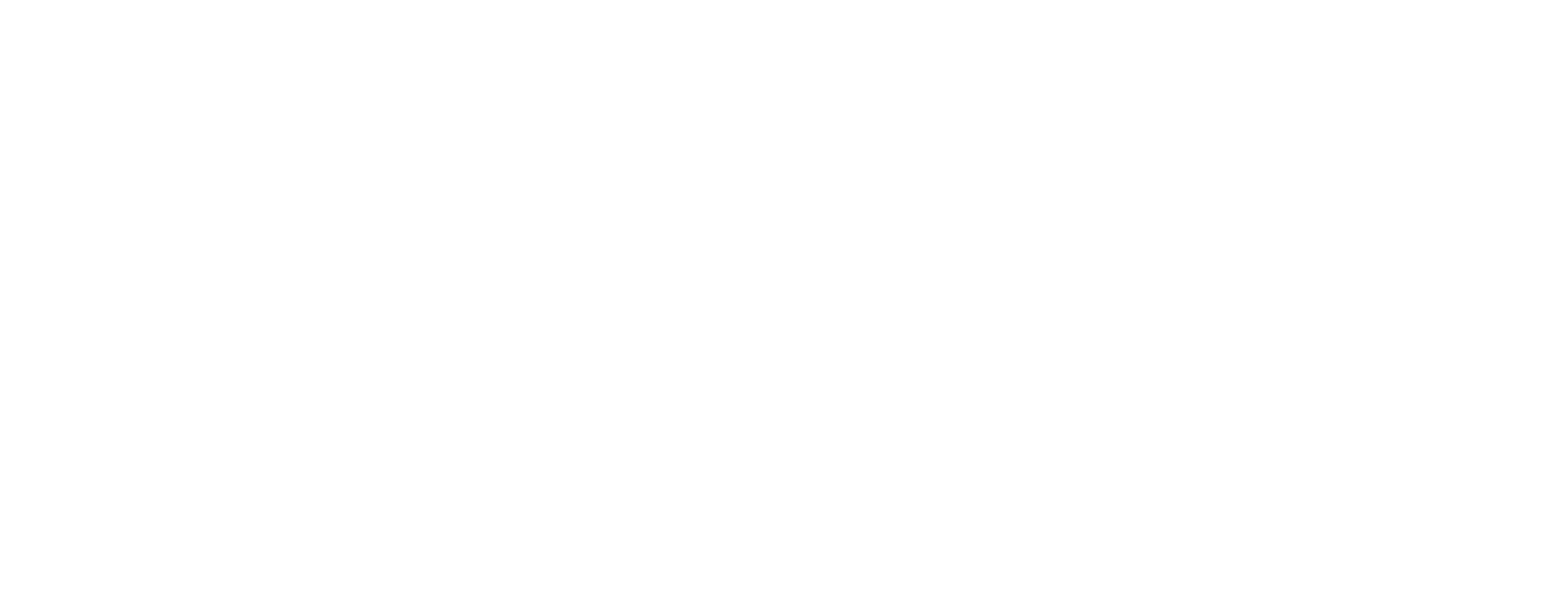Élément incontournable des cosmétiques et source de revenus et d’indépendance de nombreuses femmes marocaines, l’argan se fait rare.

Hydratante, riche en antioxydants, en vitamines, revitalisante… Les propriétés de l’argan sont nombreuses. Mais au Maroc, l’argan, c’est bien plus que cet ingrédient miracle exploité par l’industrie des cosmétiques : c’est un véritable emblème autour duquel se déploient de nombreuses traditions, toutes entretenues par des femmes. Chargées de sa récolte depuis des décennies, ces coopératives féminines – employant des Amazighes pour la plupart -, effectuent un travail pénible, accroupies au-dessus de moulins à pierre, pour écraser les grains à la main. Une tâche difficile qui rapporte peu (3 dollars pour 1 kilo, soit environ deux jours de travail, contre 60 dollars il y a trente ans), mais qui s’accompagne de fierté. “Nous sommes nés et avons grandi ici. Ces traditions viennent de la nature, de ce que nos parents et grands-parents nous ont appris et de ce dont nous avons hérité,” explique Fatma Mnir, collaboratrice de la coopérative Ajddigue, située à l’extérieur d’Essaouira, à AP News. Le problème, c’est que ces traditions pourraient bien être menacées.
Urgence climatique
Poussant dans les collines arides situées entre l’océan Atlantique et les montagnes de l’Atlas, les arganiers faisaient office de barrage, empêchant le désert de s’étendre, tout en nourrissant hommes et animaux de la région. Très résistants, ces arbres épineux peuvent survivre avec seulement 2,5 cm de pluie par an et par des températures pouvant atteindre 50 degrés, grâce à des racines qui s’enfoncent jusqu’à 35 mètres sous terre. De véritables forces de la nature que l’on aurait jamais imaginé être affaibli par la sécheresse. Et si la nouvelle période de récolte n’est pas encore finie (elle dure de juin à septembre, ndlr), elle n’engage déjà rien de bon : malgré des précipitations plus abondantes que l’année précédente, elles restent en deçà des moyennes habituelles. Un manque d’eau également encouragé par d’autres cultures, de pastèques, d’orges ou de tomates, qui s’étendent sur les arganeraies, puisant dans les nappes phréatiques. Résultat ? Les forêts se parsèment, les arbres portent moins de fruits et les vols se font de plus en plus nombreux. Une forêt qui couvrait environ 14 000 kilomètres carrés au tournant du siècle a diminué de 40 %, alertant les scientifiques de la région, comme Zoubida Charrouf, chimiste qui étudie l’arganier à l’Université Mohammed V de Rabat, “Parce que les arganiers ont agi comme un rideau vert protégeant une grande partie du sud du Maroc contre l’avancée du Sahara, leur lente disparition est considérée comme une catastrophe écologique”.
Un manque d’eau qui éprouve les arganiers et qui impacte le climat, mais aussi les Marocains, qui vivent directement ou indirectement de cette industrie. Interrogée par Géo, Aïcha, une travailleuse du Souss, se désole de cette évolution : “Avant, il y avait tellement de fruits qu’on en laissait, on ne pouvait pas tout ramasser. Mais maintenant, c’est fini. On a déjà connu des périodes dures mais cela commence à être compliqué pour moi car c’est ma seule source de revenu.” Elle poursuit : “L’arganier, c’est comme de l’or pour nous. On le récolte, on le stocke, on peut le vendre ou l’utiliser en cuisine.” Le problème, c’est que les fruits et les fleurs poussent plus tôt chaque année, car la hausse des températures désynchronise les saisons. Et bouscule donc le marché, affaibli par un Covid qui a perturbé la demande et les prix, faisant fermer de nombreuses coopératives.
Les femmes, premières victimes
Si les arganiers appartiennent à tout le monde, l’extraction de l’huile, elle, est une affaire de femmes qui font de leur labeur un espace de sororité. “Ici, on parle de tout, de nos maris, de nos parents, du coût de la vie…”, raconte Aïcha à Géo. Un espace essentiel pour celles qui sont les premières à souffrir de la précarité de la culture de l’argan. Professionnalisée dans les années 1990, la récolte s’organise aujourd’hui en coopérative, notamment sous l’impulsion de Zoubida Charrouf, docteure en chimie et professeure à l’université Mohammed-V de Rabat, qui explique, dans le même article, avoir “voulu que les gens prennent conscience des débouchés possibles de l’arganier”. “Jusqu’alors, les femmes, notamment les Berbères, détentrices d’énormément de connaissances sur cet arbre, produisaient de façon indépendante, chez elles. Je les ai incitées à s’organiser pour gagner mieux leur vie. Les Marocains ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça pour des femmes, souvent marginalisées dans ces milieux ruraux. Maintenant, elles marchent la tête haute. L’épicier du coin accepte de leur faire crédit et elles peuvent envoyer leurs enfants à l’école”.
Une avancée qui se voit aujourd’hui freinée par la situation climatique, mais aussi par le capitalisme. Et oui, les grandes entreprises se saisissent elles aussi de l’argan pour faire de l’argent. Selon les données des coopératives locales, une entreprise, Olvea, contrôle 70 % du marché d’exportation. “Entre la villageoise et l’acheteur final, il y a quatre intermédiaires. Chacun prend une commission. Les coopératives n’ont pas les moyens de stocker, alors elles vendent à bas prix à quelqu’un qui paie d’avance,” souligne Id Bourrous, président d’un syndicat, à AP News. Pour Rqia, une travailleuse citée par Géo, le marché de l’argan et la disparition des arbres ne tuent pas seulement les traditions, mais contribuent à rendre les femmes dépendantes. “Avant, si nous, les femmes, on voulait acheter quelque chose, les hommes nous disaient de faire de l’argan. Mais depuis cinq ans, plus personne ne m’apporte sa récolte. Cela fait trois ans que je n’ai pas sorti ma presse. Si l’arganier disparaît de notre région, les femmes n’auront plus rien.” Responsable commerciale d’un groupement de six coopératives comptant 525 adhérentes, Latifa Anaouch conclue : “L’argan devient très cher, mais cela ne profite malheureusement pas aux récoltants, seulement aux spéculateurs. Même les grandes sociétés de cosmétiques considèrent que c’est trop cher et nous avons perdu beaucoup de clients.” De plus, le chercheur Hassan Faouzi affirme dans les colonnes de Media24 qu’ “une grande partie de l’huile d’argan qui circule au Maroc n’est pas pure” et est issue de mélanges frauduleux avec des huiles végétales moins coûteuses ou des amandons digérés par les chèvres. Des adultérations qui détériorent la qualité du produit. Mais qui contribuent à faire exploser la demande.
Une issue est-elle possible ?
Conscient de cette crise, le gouvernement marocain souhaite interdire l’exportation de l’huile d’argan en vrac à horizon 2030, au profit de l’exportation en bouteilles. Inquiet de la disparition des arbres, il entend également replanter plus de 50 000 arbres d’ici à cinq ans. Depuis 2018, le projet DARED (Développement de l’Arganiculture en environnement Dégradé) tente également de régénérer les zones fragilisées en plantant des arganiers alternés avec des cultures de câpres, mais la production n’a pas encore démarré à cause de la sécheresse. Et dire qu’il y a quelque temps, ces derniers poussaient à l’état sauvage…
Dernière mesure, jusqu’alors peu fructueuse : la construction de centres de stockage pour aider les producteurs à conserver leurs produits plus longtemps et à négocier de meilleurs prix. Si les coopératives ne constatent jusqu’alors pas d’amélioration, une nouvelle version est attendue en 2026, avec moins d’obstacles à l’accès.
9 août 2025