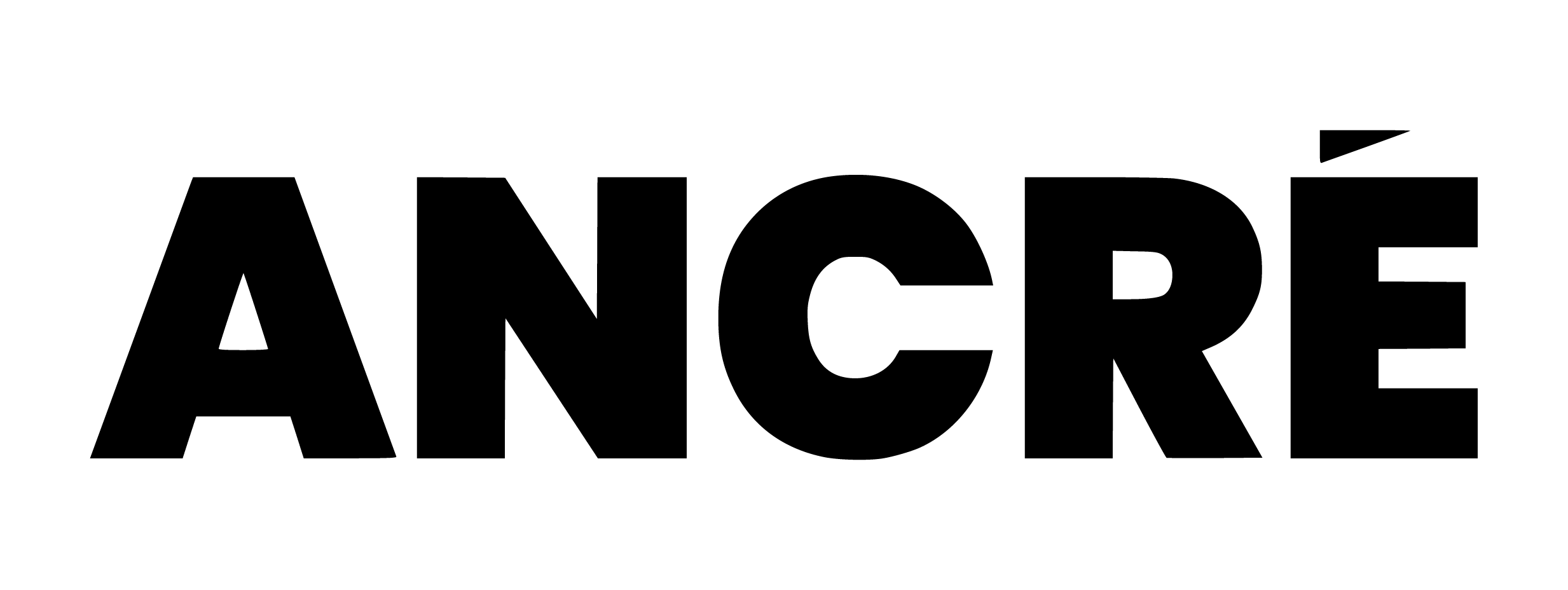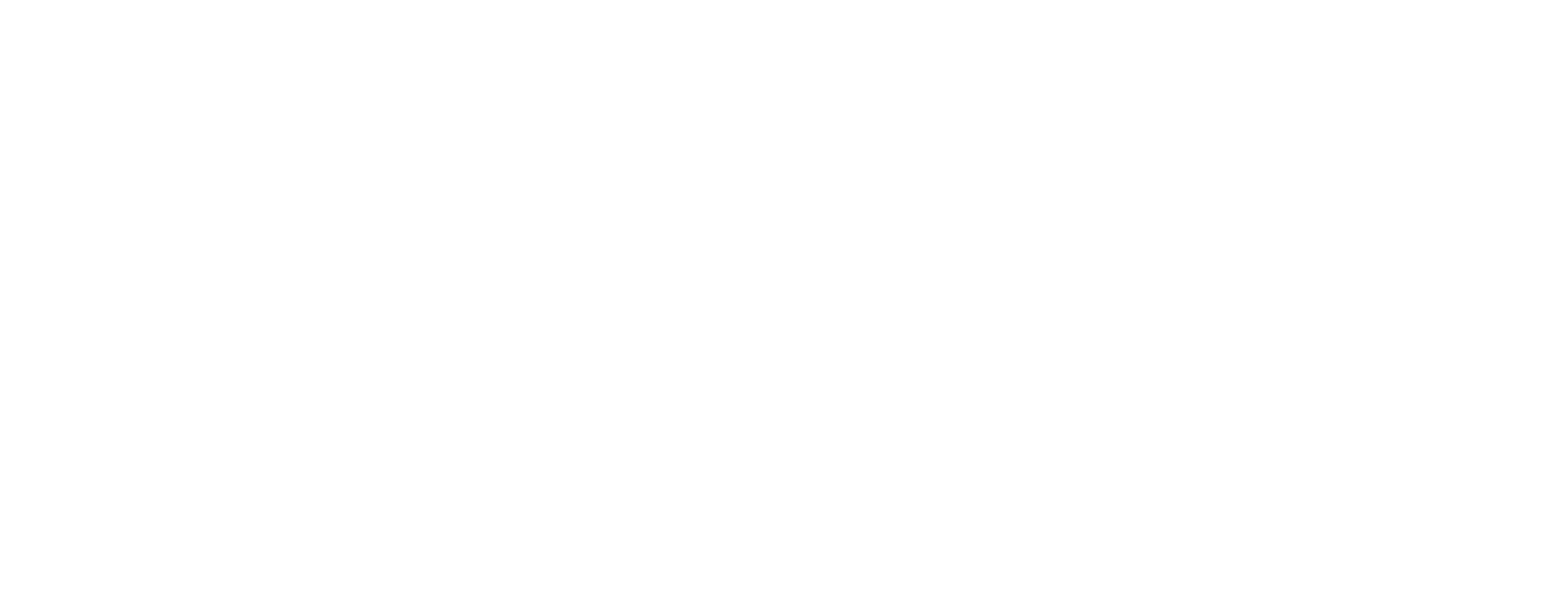À l’origine destinées aux populations les moins aisées, les friperies sont désormais prises d’assaut par les bobos aux portefeuilles bien garnis, qui ont lentement fait d’un secteur social une nouvelle élite aux prix parfois hallucinants.

Il fut un temps où s’habiller avec de la seconde main n’était pas une fierté, mais souvent une nécessité. “Les classes les plus hautes considèrent les friperies comme des magasins de jouets. Un endroit où trouver des choses amusantes, une sorte de terrain de jeu. Pourtant, la classe populaire y voit l’un des derniers endroits où elle peut se permettre d’acheter les biens nécessaires adaptés à son niveau de vie”, résume Spencer James, chercheur à l’Université d’État de Pennsylvanie, dans une étude consacrée à l’évolution de la seconde main. Avec l’avènement de sites comme Depop, Vestiaire Collective ou Vinted, la fripe revêt un côté ludique, et devient le théâtre d’une chasse aux trésors, l’argument éthique en plus. Difficile de le nier : la seconde-main s’est embourgeoisée, et il suffit de se balader dans le Marais pour constater que les ressourceries d’hier sont devenues des dépôts vente de luxe, que l’on explore au son d’une playlist alternative, un matcha à la main.
Le tournant du numérique
Fin février 2025, une vidéo YouTube fait l’effet d’une bombe. Baptisé “LES SHOPS VINTAGE VOLENT LES VÊTEMENTS DES PAUVRES ?”, le reportage est signé Céline – alias Maison Cee –, une influenceuse devenue célèbre grâce à ses vidéos de déballages de colis Vinted. “J’ai arrêté les hauls Vinted, friperie, vintage… Je me suis rendue compte que c’était un outil du capitalisme tendance. Tout ça nous pousse à racheter le petit haut à la mode du printemps”, annonce-t-elle dans sa vidéo. Alors que sa promesse était de mettre un frein à la surconsommation, la seconde-main ne suivrait-elle pas finalement les mêmes dynamiques de marché que le neuf ? Pour Emmanuel Durand, anthropologue (IRIS-EHESS) et autrice du livre “L’envers des fripes”, cela ne fait aucun doute, “les plateformes numériques de vente entre particuliers reprennent les codes de la surconsommation”. Elle poursuit : “L’offre est infinie. Quand on est sur Vinted, on a jamais fini de scroller, l’offre est tellement dense et importante que rien que ça, ça vient faire écho à la surproduction de l’industrie du textile et de la fast-fashion”. Créée en 2008, Vinted a généré 813,4 millions d’euros de chiffre d’affaires et 77 millions de bénéfices en 2024, soit quatre fois plus que l’année précédente. Et cela, rien qu’en France. Fort de son succès, l’ancienne start-up lituanienne s’est récemment lancée dans le luxe et avait célébré ce nouveau segment avec la très fermée “House of Vinted”. Si le succès de la plateforme est due aux Vinites de la première heure qui ont revendu et acheté des affaires à petit prix, sont-ils aujourd’hui poussé à déserter l’application ?
“Le côté positif avec Vinted ou même Backmarket (l’équivalent pour les objets électroniques, ndlr) c’est que ces marques super-puissantes sont hyper efficaces, et ont permis de déringardiser la seconde main. Acheter d’occasion permet de prolonger la durée de vie du vêtement”, souligne Mathieu Janich, consultant-chercheur en communication responsable, dans les colonnes d’actu.fr. Mais en marketant la seconde-main et en ouvrant sa plateforme aux professionnels, Vinted s’est également éloigné de son plaidoyer de base, encourageant les “Vinties” à acheter pour revendre. Et donc, à surconsommer. Pour se faire le plus d’argent possible, les professionnels ne se contentent pas de photos de vêtements froissés négligemment jetés sur un coin de lit, mais posent face caméra comme des mannequins chevronnés et font tout pour proposer la même direction artistique que n’importe quelle boutique en ligne. Marianne Gybels, Directrice du développement durable chez Vinted, en est sûre : “Ce n’est qu’en rendant les produits de seconde main désirables que les consommateurs se tourneront en premier lieu vers les produits de seconde-main”. Sauf qu’avec la désirabilité, vient la montée des prix. On ne paye plus juste un vêtement qui a déjà servi, on paye un service, une image, et une curation. Et ça, ça a un coût. Des “acheteur-revendeurs” utilisent même des bots qui achètent automatiquement sur Vinted afin de revendre ces mêmes produits bien plus chers, parfois même plus qu’en boutique et ce, grâce à un mot clé : “vintage”.
Où est la solidarité ?
Car oui, cette augmentation des prix passe aussi par le vocabulaire : on n’achète pas simplement de la seconde-main, mais du vintage, des pièces annoncées comme rares, de collections ou simplement ultra-tendances. Achetés 10 euros en moyenne par les revendeurs, les pantalons Carhartt se vendent par exemple autour de 50 euros en ligne, à en croire un reportage M6 consacré au sujet. Une capitalisation qui impacte les associations implantées bien avant ce renouveau du secteur, comme Emmaüs ou le Secours Populaire qui voient les dons drastiquement réduits au profit de la revente en ligne. “On vend ce qui est de bonne qualité, on essaie d’en tirer un peu de revenus. Donc les vêtements qu’on pouvait donner auparavant à des associations, on les vend désormais sur Vinted. C’est aussi une perte de revenus pour la filière de l’Économie Sociale et Solidaire, qui valorise moins de produits”, rappelle Pauline Debrabandere, responsable plaidoyer et campagnes pour l’ONG environnementale Zero Waste France, toujours pour actu.fr. Interrogée par La Reclame, la fondatrice et directrice générale du Label Emmaüs Maud Sarda se désole : “Le paysage a beaucoup évolué par rapport au lancement de Label Emmaüs (il y a 9 ans, ndlr). Le Covid est passé par là, ce qui a été plutôt porteur pour les e-commerçants, donc pour nous aussi, mais pas uniquement pour nous malheureusement. À l’époque, Vinted était inexistant. Aujourd’hui, c’est devenu un mastodonte, avec 23 millions d’utilisateurs en France. C’est difficile de ne pas en souffrir.” Dons de moins bonnes qualités, voire quasi-inexistants, achat-revente par des particuliers, et concurrence toujours plus accrue, le modèle solidaire serait-il en péril ? Pour la secrétaire nationale en charge de la solidarité du Secours Populaire Houria Tareb, cela ne fait aucun doute. “Avant, on avait des dons de meilleure qualité, car il n’y avait pas les sites comme Vinted. Aujourd’hui, on se retrouve à gérer une arrivée massive de dons de vêtements de très mauvaise qualité, très souvent abîmés et que l’on ne peut pas donner aux personnes qui sont dans le besoin. Les gens donnent tout et n’importe quoi, certains nous prennent pour une poubelle, une déchetterie.”
Socle de la seconde main, la solidarité semble avoir disparu du secteur. Et cela n’est pas uniquement dû à l’expansion de Vinted ou du boncoin. Achetant leurs stocks au ballot auprès des associations débordées par la quantité de vêtements laissés dans des bornes Relais, les grossistes spécialisés revendent à prix d’or ce qui a été cédé à des plateformes de tri qui ne gardent que 3% de ce qui a été légué, le reste étant brûlé, recyclé ou, à 54%, exporté en Afrique. “C’est un système dégueulasse, résume Chloé, fondatrice de Digger club, auprès de Maison Cee, T’as des trucs collectés en Allemagne qui sont collectés à Dubaï pour être triés par des personnes précaires, pour être vendus en Europe, puis aux États-Unis… Les trucs font quatre fois le tour du monde dans des conteners”. Si la chineuse professionnelle a fait le choix de la curation à la main, c’est par amour des pièces bien choisies, mais aussi par respect pour l’industrie. “Je sais à qui je donne mon argent. Quand je travaille avec des grossistes, je travaille avec des gens qui ont des multinationales et qui appauvrissent des gens à l’autre bout du monde”. Et oui : acheter de la seconde main, ce n’est pas forcément acheter éthique. Alors que les populations les plus aisées tapent facilement sur les mains des consommateurs de fast-fashion, leur rapport au textile n’est pas nécessairement plus vertueux.
L’offre et la demande
La faute à… la fast-fashion. Car oui, le marché de la seconde-main dépend nécessairement du marché du neuf. Et aujourd’hui, acheter neuf signifie bien trop souvent acheter de la mauvaise qualité. Les boutiques vintage apparaissent alors comme la solution pour s’habiller mieux et porter des vêtements qui sont produits dans de meilleures conditions et qui durent plus longtemps dans le temps. Problème : trouver ce genre de pièce aujourd’hui, c’est de plus en plus compliqué. Et comme ce qui est rare est cher, les prix grimpent et font de ce marché un secteur de plus en plus luxueux. De plus, même lorsque l’on possède déjà ce genre de pièces (peut être grâce à un héritage ou à une super trouvaille chez Guerrisol), l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat nous encouragent à les céder sur Vinted ou en brocante afin de se faire un peu d’argent. Que l’on réinvestit, malheureusement, dans plus de vêtements à bas prix sur des sites de fast-fashion. Une inflation qui touche également les boutiques spécialisées, qui ne cherchent pas forcément à attirer une clientèle bourgeoise, mais plutôt à célébrer l’amour du vêtement bien fait et des styles marqués des époques précédentes. Les augmentations du coût de la vie, des charges, des loyers s’ajoutent à celle des pièces, qui se font de plus en plus difficile à sélectionner. Résultat : des fripes toujours plus chères et des clients toujours plus fortunés. Et une gentrification qui s’installe.
La clientèle des friperies ayant évolué, l’esthétique et l’offre de ces boutiques également. Plus proche du concept-store branché que de la ressourcerie, la plupart de ces échoppes misent sur une expérience et excluent, dès la vitrine, les populations auxquelles s’adressaient ce marché. Plus encore, en suivant les tendances à outrance, comme celles de l’oversize ou de l’upcycling, le vintage écarte également de nombreux corps de ses boutiques, ne proposant que rarement des vêtements grandes tailles avec pour argument principal que les gens étaient plus minces avant. “Je ne suis pas sûre que les gens étaient nécessairement plus minces, mais je pense que les personnes rondes étaient encore plus marginalisées, et personne ne fabriquait de vêtements pour nous”, explique Rachael Frank, cofondatrice de Thick Thrift à Vogue. Si elles sont déjà presque inexistantes, à cause des réseaux sociaux, le peu de pièces grande tailles sont aujourd’hui achetées par des personnes à qui ces vêtements ne sont pas destinés. Les vestes grandes tailles sont portées par des corps minces quand les t-shirts en 44 et plus sont transformés en petites robes cintrées par des apprentis couturiers. C’est ce qu’on appelle le thrift flip, et ça cartonne sur TikTok.
Résultat, ce qui promettait d’être un modèle plus éthique reproduit finalement les dynamiques sélectives du monde de la mode, excluant les personnes les plus pauvres, ou les corps différents qui doivent se contenter des miettes. “La mode pille sans scrupule les subcultures depuis des décennies, rappelle un article du WWD cité par Le 24heures, Ce qui était accessible aux classes modestes devient alors un luxe.” Alors oui, acheter de la seconde main, c’est indéniablement mieux pour la planète (même si le modèle est aussi loin d’être parfait que ce que l’on voudrait croire), mais choisir de valoriser ce marché là ne doit-il pas s’accompagner d’une dimension plus sociale, plus inclusive ? Car finalement, c’est ça la gentrification : décréter que quelque chose consacrée à une population plus marginalisée est cool, se l’approprier, et ne plus jamais s’adresser à la clientèle de base. Pour la sociologue Anne Clerval, “la gentrification ne connaît pas de bouton d’arrêt. Une fois lancée, elle s’auto-alimente”. Et désolée de le dire, mais c’est exactement ce qu’il se passe avec le monde de la fripe.
5 août 2025